Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le contexte
La surcharge de travail est identifiée comme le premier risque professionnel affectant la santé mentale des salariés.
Il s’agit donc d’une affection majeure, bien connue des entreprises et des directions des ressources humaines, à laquelle au-delà des apparences elles n’apportent souvent aucune solution.
Les causes de la surcharge de travail peuvent être multiples : pression de la hiérarchie, exigences liées au poste, sous-effectif de l’entreprise….
Elles sont, la plupart du temps, largement aidées par les outils indispensables que l’employeur met à la disposition du salarié : ordinateur et téléphone portables, qui permettent l’envoi et la consultation de messages en toutes circonstances : le soir, les week-ends et fréquemment pendant les congés.
Le salarié, victime de cette surcharge, a le sentiment d’être pris dans un engrenage sans fin dont il ne parvient pas à s’extirper.
Pourtant, les conséquences à terme sur l’état de santé sont largement documentées : la surcharge de travail, lorsqu’elle est récurrente ou chronique, mène à terme à un état d’épuisement professionnel (burnout).
Il convient toutefois de rappeler que la durée du travail des salariés, excepté celle des cadres dirigeants, qui n’y sont pas assujettis, est encadrée par les dispositions du code du travail et certaines directives européennes, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en donnant une interprétation stricte.
Première des obligations à laquelle est tenu l’employeur : l’obligation de sécurité
Les conséquences néfastes de la surcharge de travail sur l’état de santé du salarié obligent l’employeur à réagir.
Au titre de l’obligation de sécurité, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L 4121-1 du Code du travail).
Il en résulte que l’employeur est requis de veiller, en vertu de son obligation de sécurité, à ce que les conditions de travail du salarié ne soient pas dégradées du fait d’une charge de travail excessive.
C’est ainsi que lorsque l’employeur est alerté par un salarié d’une surcharge de travail, il doit sans délai prendre les mesures effectives pour que cette situation cesse.
Il est donc utile que le salarié écrive, de préférence au responsable des ressources humaines, afin de l’informer formellement de cette situation.
Cette démarche s’impose quand bien même l’intéressé pourrait douter de son efficacité, alors que le responsable des ressources humaines connaît parfaitement cette situation devant laquelle il préfère fermer les yeux.
Il n’en demeure pas moins qu’une trace écrite est toujours préférable, préventivement à un éventuel de litige…
Des durées de travail maximales fixées par le code du travail
Le code du travail fixe plusieurs bornes à la durée maximale du travail, qui sont d’ordre public, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à y déroger.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures (article L 3121-18 du Code du travail).
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (article L 3121-20 du Code du travail), étant précisé que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut, sauf rare exception, dépasser 44 heures (article L 3121-22 du Code du travail).
S’agissant des repos hebdomadaires, Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 du Code du travail).
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives (article L 3132-2 du Code du travail).
Tout salarié bénéficie en outre d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail).
Contrat de travail prévoyant un forfait jours, obligation d’un suivi régulier de la charge de travail
De nombreux cadres, et autres salariés bénéficiant d’une autonomie, ont signé un contrat de travail qui prévoit un forfait en jours sur l’année (habituellement 218 jours), sans référence à une durée hebdomadaire de travail.
Cette convention de forfait jours ne constitue pas pour autant un blanc-seing donné à l’employeur pour se livrer à tous les excès et considérer que le salarié peut travailler au-delà des durées maximales qui ont été évoquées.
La Cour de cassation pose avec constance deux règles essentielles :
D’une part, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Elle ajoute que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cette exigence impose à l’employeur de « s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » (article L 3121-60).
Elle se décline par l’obligation d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
En particulier, l’employeur doit communiquer périodiquement sur la charge de travail du salarié, et sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle (article L 3121-64 du Code du travail).
Mais cet entretien, qui se résume souvent à un sujet vite abordé et guère approfondi lors d’un entretien d’évaluation, a une importance que les employeurs ont tendance à négliger.
Salarié évoquant une surcharge de travail au cours de son entretien d’évaluation
Les entretiens de façade sont insuffisants lorsqu’un salarié évoque une surcharge de travail, postulant que sa durée de travail n’est pas raisonnable.
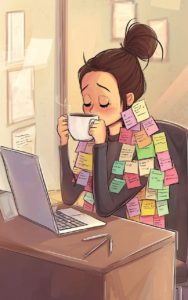 Ainsi, une salariée avait fait état de difficultés de surcharge de travail et d’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée lors de plusieurs entretiens trimestriels, sans que l’employeur réagisse.
Ainsi, une salariée avait fait état de difficultés de surcharge de travail et d’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée lors de plusieurs entretiens trimestriels, sans que l’employeur réagisse.
Celui-ci n’avait pas institué de suivi effectif et régulier de la charge de travail de l’intéressée, qui aurait dû faire apparaître, comme le prévoyait un accord d’entreprise, le nombre d’heures de travail pour chaque jour travaillé.
Ce manquement a eu pour conséquence la nullité de la convention de forfait jours applicable à la salariée (Cass. Soc. 28 fév. 2024 n° 22-13613).
La nullité de la convention de forfait jours implique le retour à l’application de la durée légale du travail, ouvrant ainsi droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été exécutées ainsi qu’au repos compensateur.
Quelles solutions à la surcharge de travail ?
La première, tous les espoirs sont permis, consiste pour l’employeur à remédier à cette surcharge de travail en en supprimant les causes.
Plus fréquemment malheureusement, c’est l’inaction de l’employeur qui se produit.
Le salarié victime d’une surcharge de travail durable se trouve dans un état d’épuisement professionnel qui affecte son état de santé et provoque son arrêt de travail.
La perspective de retourner dans l’entreprise et de reprendre son poste s’éloigne d’autant plus que cet arrêt est de longue durée, étant observé que la reconstruction personnelle nécessite souvent du temps.
Il est indispensable que le salarié prenne contact avec le médecin du travail afin de l’informer de sa situation, et qu’il se rapproche également des représentants du personnel afin qu’ils en aient connaissance.
Les préconisations du médecin du travail concernant un éventuel changement ou aménagement de poste doivent être impérativement suivies par l’employeur, conformément aux dispositions du code du travail (article L 4624-6).
En outre, si le médecin du travail considère que le salarié n’est pas apte à reprendre son poste, son état de santé ne le lui permettant pas, il rendra un avis d’inaptitude, prélude probable à une rupture du contrat de travail.
La responsabilité de l’employeur en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et de rupture du contrat de travail
Une surcharge de travail, lorsqu’elle est la cause d’un burnout du salarié, peut faire l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle de la Caisse d’assurance maladie, voire dans certaines circonstances d’une faute inexcusable de l’employeur.
L’inaptitude d’origine professionnelle permet entre autres l’octroi au salarié d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement (article L 1226-14 du Code du travail).
En outre, en cas de contestation de son licenciement pour inaptitude par le salarié, la jurisprudence juge régulièrement que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass. soc. 6 juill. 2022 n° 21-13387).
L’inobservation par l’employeur des règles de sécurité, dont la surcharge de travail constitue une illustration, peut par ailleurs justifier selon les circonstances une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.


