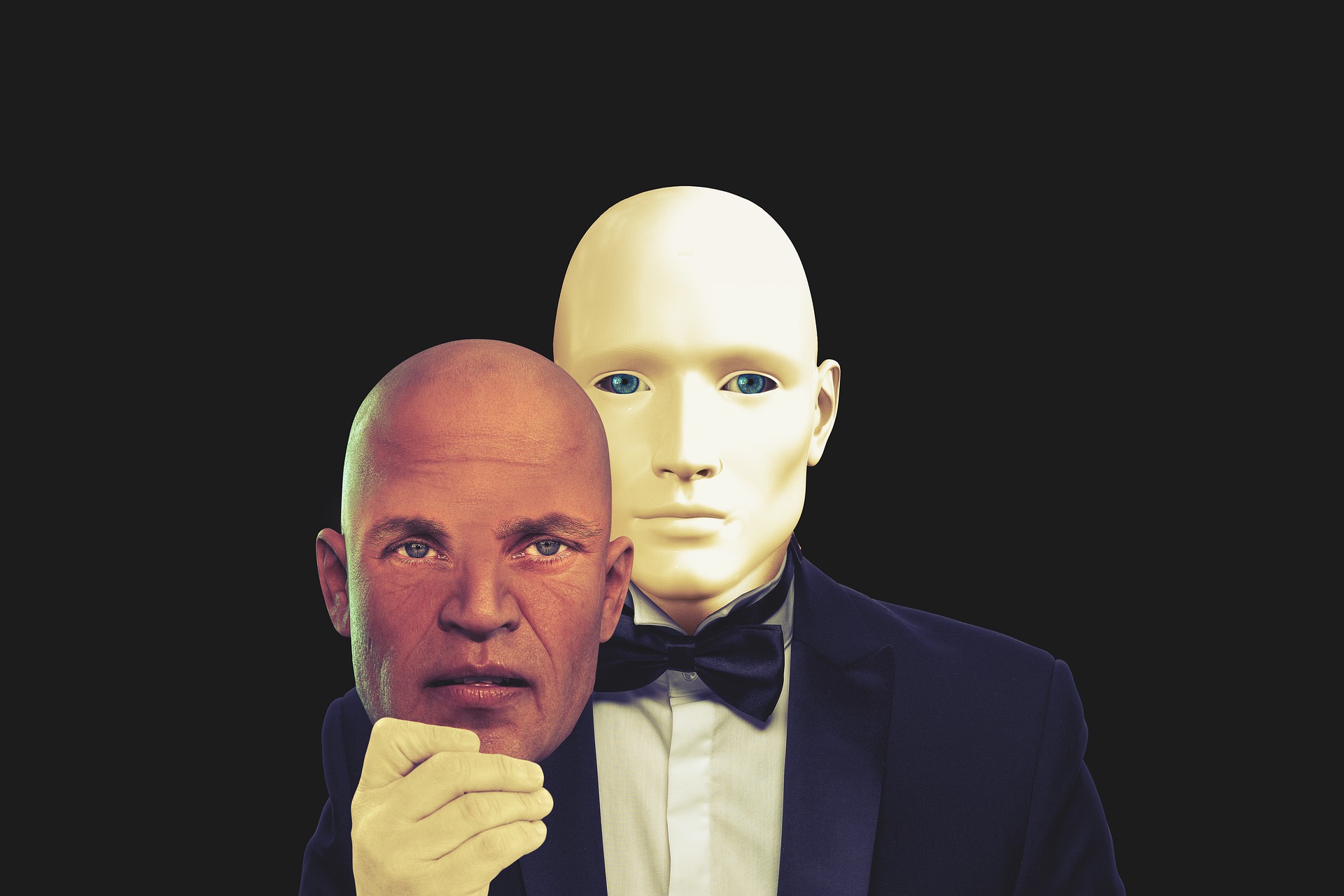Le salarié qui souhaite engager une action contre son employeur devant le Conseil de Prud’hommes, quelle qu’en soit la nature (contestation de la rupture de son contrat de travail, harcèlement, paiement d’heures supplémentaires ou de primes, etc….), doit impérativement produire des pièces au soutien de ses demandes. Cette affirmation, qui peut paraitre une évidence, requiert néanmoins du salarié qu’il dispose de pièces et qu’il ne se lance pas dans une telle démarche les mains vides, au risque probable d’un échec.