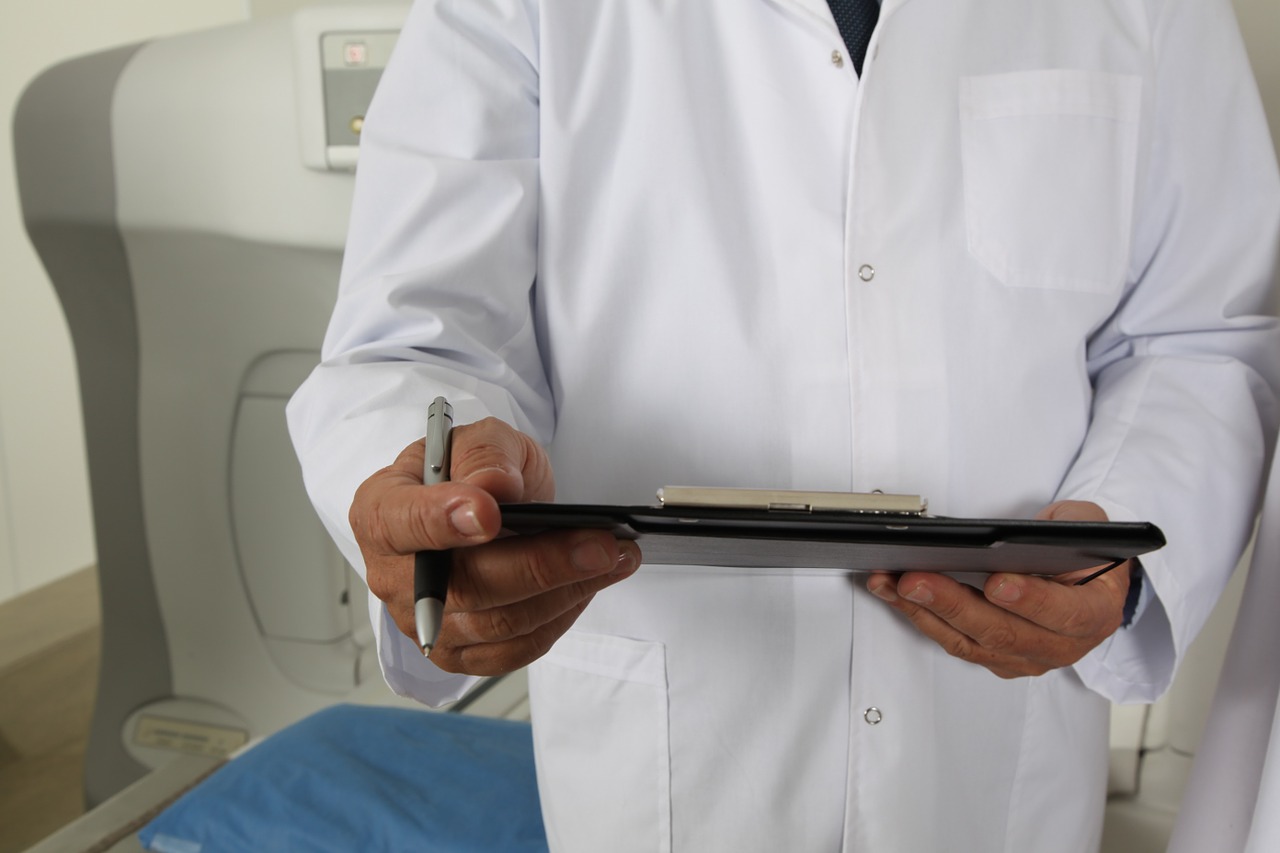La relation de travail dans une entreprise est sujette à des vicissitudes et le parcours d’un salarié peut alterner plusieurs phases. Ainsi, il peut connaître une évolution positive pendant une longue période au cours de laquelle, auréolé de ses succès et soutenu par sa hiérarchie, il bénéficie de marques de reconnaissance qui lui sont accordées (augmentation de salaire, promotion…), puis après la survenance d’un évènement particulier affectant son environnement professionnel, se voir subitement tomber en disgrâce et privé d’une part importante de ses attributions.