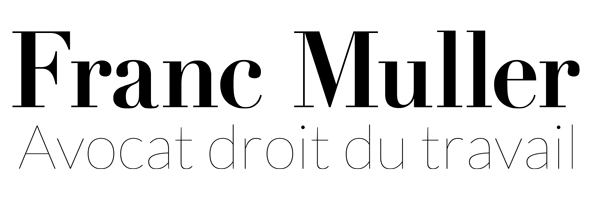Un employeur peut-il exiger d’un salarié une condition de présence dans l’entreprise pour le faire bénéficier d’une prime se rapportant à une période antérieure au cours de laquelle il a travaillé ? Cette question intéresse les salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération variable, la part variable étant liée à l’atteinte d’objectifs fixés selon une périodicité déterminée. Bon nombre d’employeurs apportent une réponse négative à cette interrogation, peu enclins à débourser une certaine somme à un salarié qui a démissionné ou est licencié.