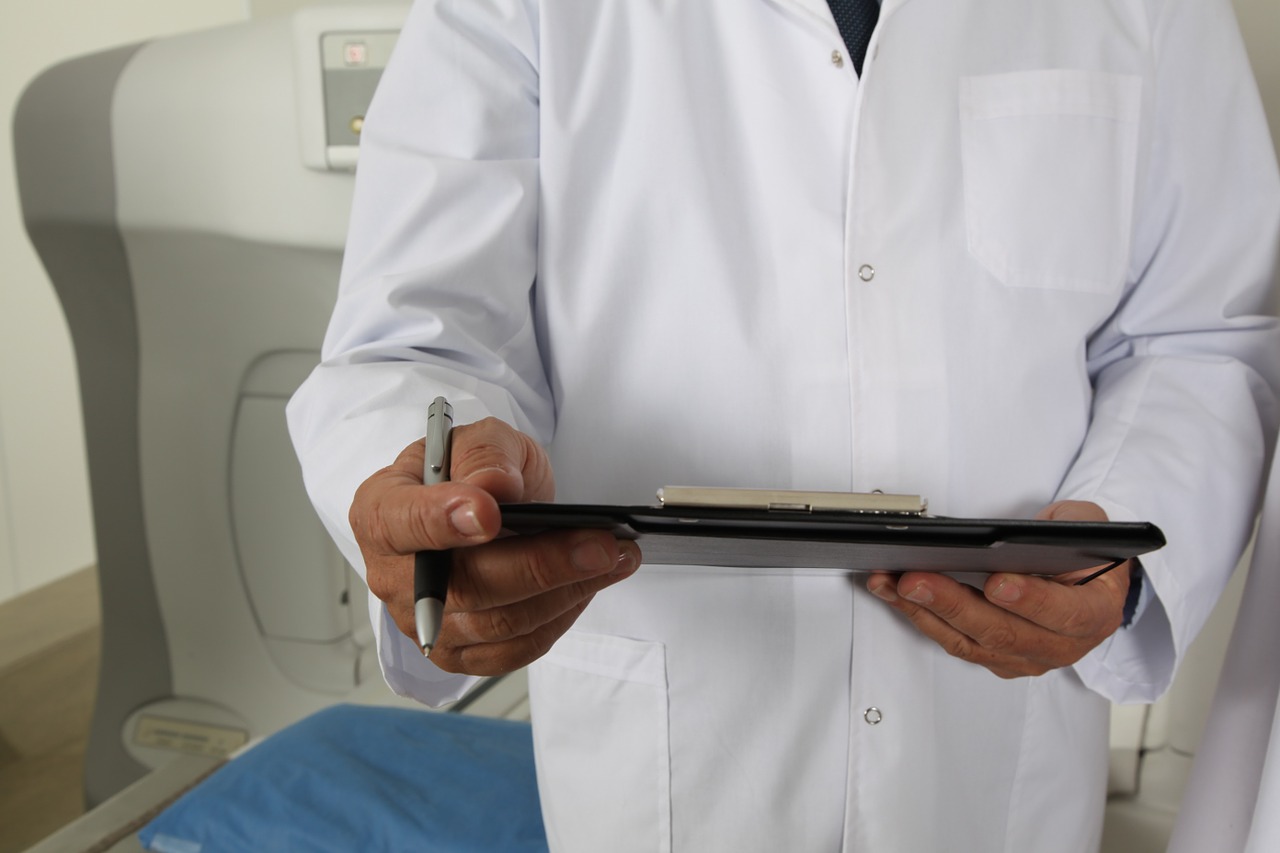Quand un salarié reçoit une lettre de licenciement, la première interrogation porte sur le motif énoncé par l’employeur. Le licenciement pour motif personnel est habituellement fondé soit sur un motif disciplinaire, soit sur une insuffisance professionnelle, qui en caractérisent les deux principales catégories. Pour faire court, le licenciement pour motif disciplinaire est celui qui repose sur un comportement fautif du salarié, et donne lieu selon le degré de la faute invoquée par l’employeur à un licenciement pour « faute sérieuse », faute grave ou faute lourde.