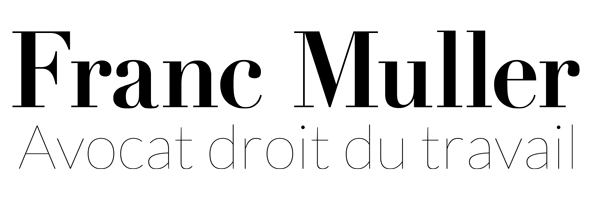Le droit, et le droit du travail particulièrement, est une matière dans laquelle le formalisme tient une place déterminante.
A tel point que lorsque les formes imposées par le Code du travail ne sont pas respectées, c’est la validité de l’acte lui-même qui peut s’en trouver affectée.
La loi encadre ainsi de manière très stricte la procédure de licenciement et les délais relatifs à la convocation à l’entretien préalable ainsi qu’à l’envoi de la lettre de licenciement.
De telle sorte, par exemple, que le fait, pour un employeur, d’annoncer verbalement à un salarié qu’il est licencié sans respecter les formes requises, rend nécessairement ce licenciement dénué de fondement.