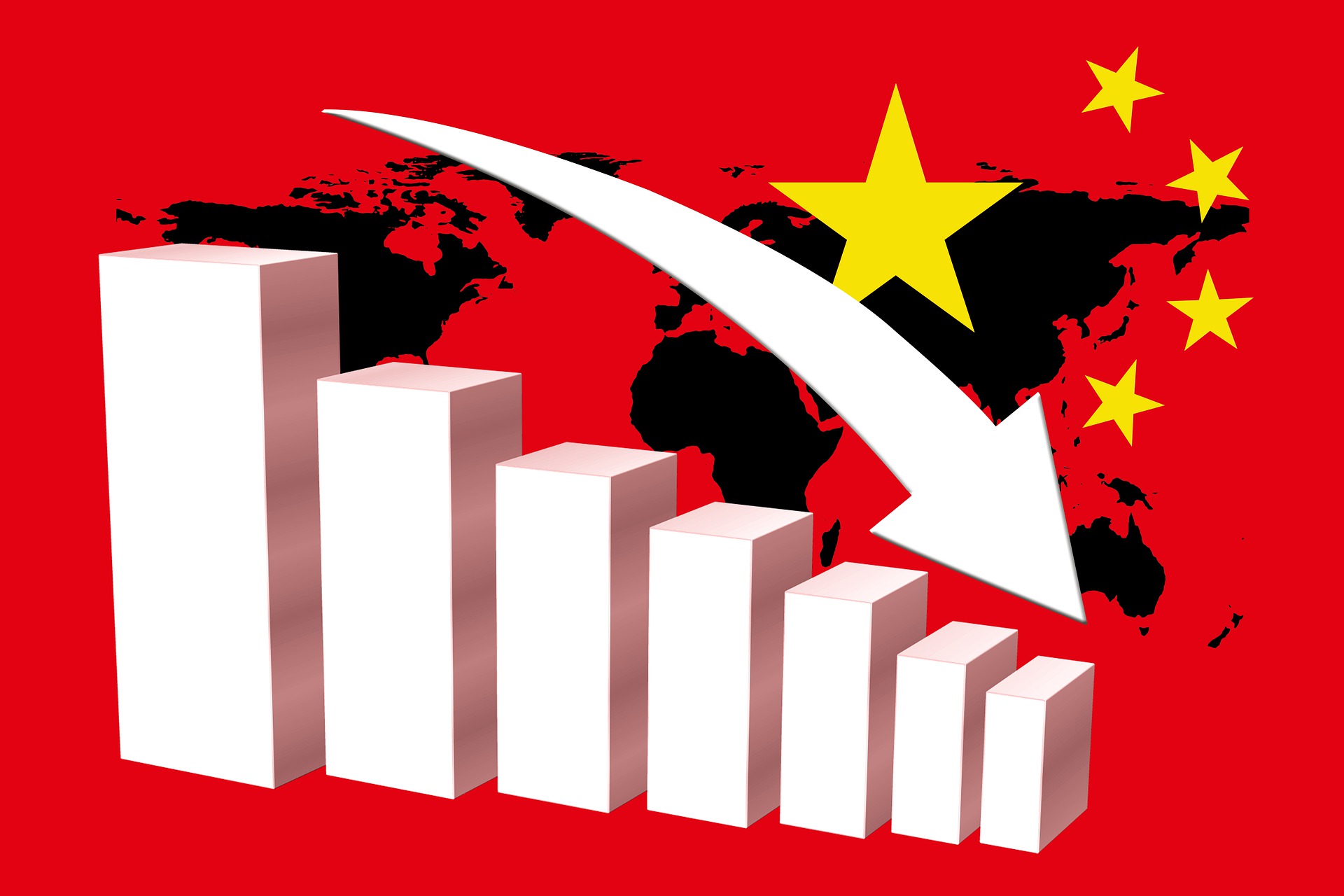Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Un cadre défini par le Code du travail
Le licenciement pour motif économique répond à des exigences légales très précises, qui lorsqu’elles ne sont pas réunies, ont pour effet son invalidation et l’octroi au salarié d’indemnités.
Il nécessite en premier lieu l’existence d’une cause économique, laquelle doit produire des conséquences sur l’emploi du salarié.
Les causes économiques de licenciement sont listées par le Code du travail, qui en énumère trois : les difficultés économiques (1), les mutations technologiques (2), ou la réorganisation de l’entreprise (3), pour autant que cette réorganisation, et la précision est importante, soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (article L 1233-3 du Code du travail).
En outre, la conséquence la plus fréquente de cette cause économique est la suppression de l’emploi du salarié (la lettre de licenciement lui indiquant généralement que son poste est supprimé).
Mais le Code du travail envisage également deux autres conséquences, qui peuvent être soit la transformation de l’emploi du salarié, soit une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail (mutation géographique, réduction de son domaine d’activité et/ou de ses fonctions…), qu’il a refusée.
Le périmètre pertinent d’appréciation de la cause économique : l’entreprise ou le secteur d’activité
Il convient avant toute chose de s’interroger sur la structure de l’entreprise : s’agit-il d’une entreprise indépendante, ou appartient-elle à un groupe ?
Cette distinction est fondamentale car elle détermine le périmètre d’appréciation de la cause économique de licenciement.
Le Code du travail prévoit en effet que si l’entreprise n’appartient pas à un groupe, il y a lieu de considérer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, au seul niveau de l’entreprise.
En revanche, si l’entreprise appartient à un groupe (dont elle est une filiale) les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise sont considérées au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
En clair, l’appartenance de l’entreprise à un groupe, comprenant d’autres entreprises, implique de raisonner à un niveau plus large que celui de l’entreprise, qui est celui du secteur d’activité.
Précisons au demeurant que le groupe est défini par l’existence de liens capitalistiques entre les sociétés qui le compose, l’une d’elles devant posséder plus de la moitié du capital d’une autre société.
Enfin, sur le plan géographique, l’appréciation de la situation économique de l’entreprise ou du groupe se limite désormais uniquement à la France, « sauf fraude », selon la loi.
Qu’est-ce qui caractérise le secteur d’activité ?
La notion était apparue pour la première fois dans un arrêt resté célèbre de 1995, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonçant à cette occasion :
« Si la réalité de la suppression ou transformation d’emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l’entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée » (Arrêt Thomson Vidéocolor, Cass. Soc. 5 avril 1995 n° 93-42690).
Au fil du temps, les contours du secteur d’activité se sont progressivement dessinés.
En définitive, la loi Travail de 2016 a décidé d’inscrire une définition précise du secteur d’activité :
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité
Le contentieux judiciaire relatif à la cause économique de licenciement porte notamment sur l’acception du secteur d’activité qui doit être considéré.
C’est ainsi que dans une première affaire, postérieure à la définition légale, un salarié licencié contestait la validité du secteur d’activité retenu par son employeur.
Celui-ci entendait limiter les débats au secteur dentaire, alors que le salarié invoquait un spectre plus large englobant le secteur médical.
Or, les domaines d’activités dentaire et médical avaient été fusionnés en une seule division, placée sous la responsabilité d’une seule personne, afin de mettre en place une nouvelle orientation stratégique et de développer de nouveaux produits nécessitant une prospection ciblée du marché, une haute productivité et une organisation efficace.
De sorte, que les Juges du fond avaient estimé que les domaines d’activité dentaire et médical constituaient un seul et même secteur d’activité.
A cette occasion, la Cour de cassation avait posé comme règle que :
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (Cass. Soc. 31 mars 2021 n° 19-26054).
Cette jurisprudence doit beaucoup à un de ses éminents conseillers, qui affirmait dans une chronique rédigée quelques années plus tôt (le Droit Ouvrier, mars 2007, p. 142 et s.) :
« Il n’y a pas lieu de distinguer entre des activités qui, pour être différentes, relèvent du même secteur. L’automobile concerne aussi bien des véhicules à un nombre varié de roues, mus par des moteurs à essence, à gasoil ou à électricité, qui comportent de une à cinquante places ou plus, construits en acier, en aluminium ou en plastique, etc.
Un secteur distinct n’intervient que lorsque l’activité qu’il concerne est propre : la presse, par exemple, l’industrie chimique ou le nucléaire…
Pour rester accessible aux citoyens, le droit doit se garder d’entrer dans des distinctions abusives ».
La prise en compte d’un faisceau d’indices
Dernièrement, la Cour de cassation a apporté une précision supplémentaire.
Le litige opposait des salariés à leur employeur, filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerçant une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis.
Le groupe avait procédé à la fermeture de ce site, invoquant une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les salariés contestaient la pertinence du secteur d’activité retenu par leur employeur, et partant, la validité de leur licenciement.
La Cour d’appel les avait suivis dans leur argumentation, en jugeant que le secteur d’activité pertinent était celui du domaine médical et paramédical et/ou cosmétique des soins de la peau et non celui de la dermatologie de prescription.
Elle est approuvée par la Haute Juridiction, qui souligne que les Juges du fond avaient pris en considération un faisceau d’indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s’adressent et aux conditions de commercialisation sans qu’il ne soit distingué de marchés différenciés.
En conséquence, la spécialisation invoquée par l’employeur ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu (Cass. Soc. 26 juin 2024 n° 23-15503).