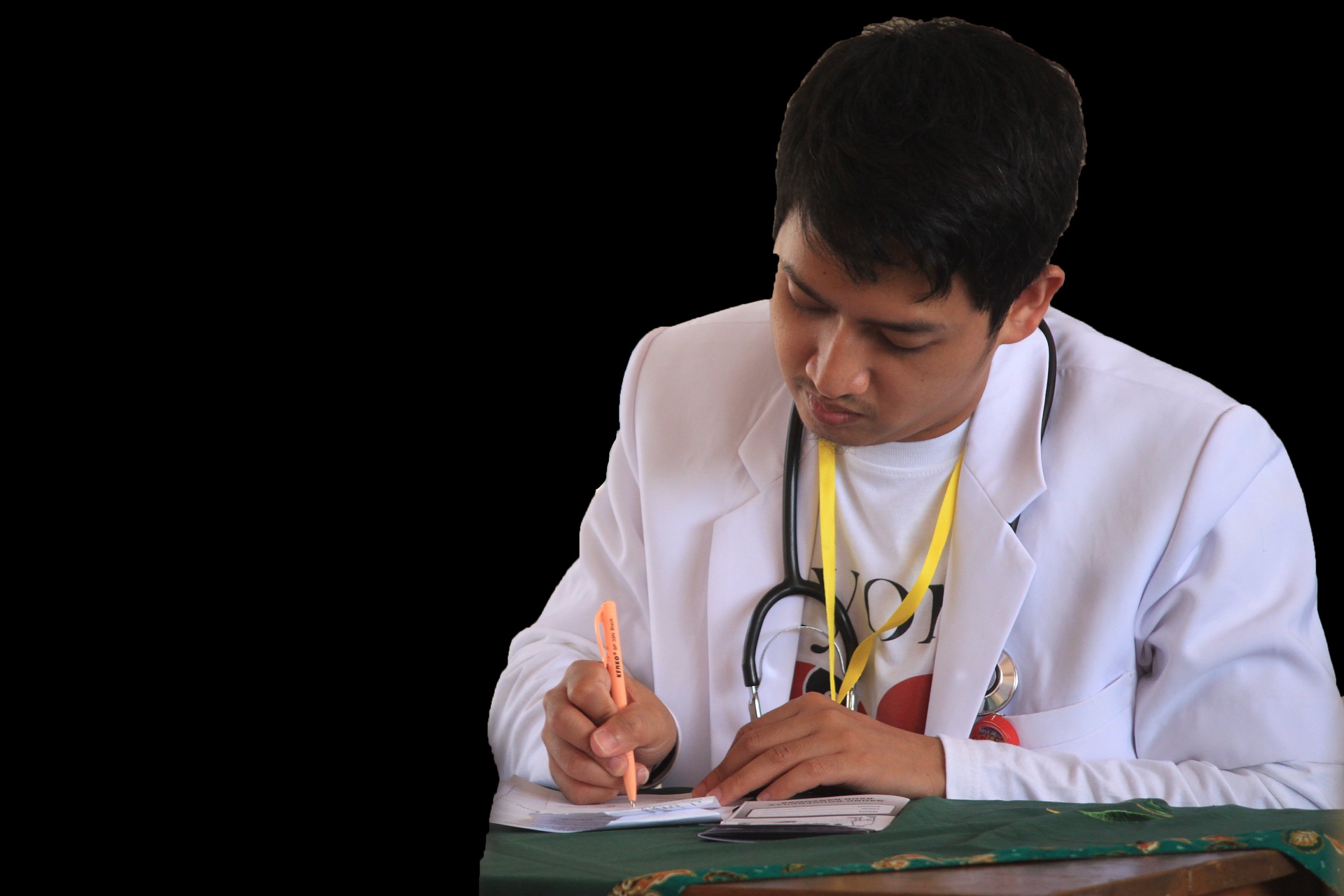Par Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Conditions dans lesquelles la visite médicale de reprise est organisée et objet de la visite
L’absence du salarié de l’entreprise pour cause de maladie au-delà d’une certaine durée, ou en cas de maladie professionnelle, impose qu’il passe une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail afin de vérifier s’il est apte, ou non, à reprendre son emploi.
Le Code du travail dispose en effet que cet examen a lieu : (1°) après une absence pour cause de maladie professionnelle (sans condition de durée), (2°) après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; (3°) après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (article R 4624-31 du Code du travail).
L’examen a pour objet de s’assurer que le poste de travail du salarié est toujours compatible avec son état de santé (article R 4624-32 du Code du travail).
Si ce n’est pas le cas, le médecin du travail peut soit proposer des aménagements ou adaptation de ce poste, soit un éventuel reclassement dans un autre emploi de l’entreprise, dont il précise les exigences.
S’il considère, en revanche, que le salarié n’est pas apte à reprendre son emploi et que l’étude de poste à laquelle il a procédé au préalable n’était pas concluante, il émet un avis d’inaptitude.
L’initiative de la visite médicale de reprise appartient normalement à l’employeur
« Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit la médecine du travail travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » (article R 4624-31 dernier alinéa du Code du travail).
Ce texte est donc très clair sur la personne de l’auteur de l’initiative de l’organisation de la visite médicale de reprise, il s’agit incontestablement de l’employeur.
 Dès qu’il est informé de la fin de l’arrêt de travail du salarié, et de sa date prévue de reprise, il lui incombe de prévenir la médecine du travail qui doit fixer un rendez-vous avec le médecin du travail, en fonction de ses contraintes d’agenda, de préférence le jour de la reprise ou au plus tard huit jours après la date de reprise.
Dès qu’il est informé de la fin de l’arrêt de travail du salarié, et de sa date prévue de reprise, il lui incombe de prévenir la médecine du travail qui doit fixer un rendez-vous avec le médecin du travail, en fonction de ses contraintes d’agenda, de préférence le jour de la reprise ou au plus tard huit jours après la date de reprise.
La jurisprudence considère à cet égard que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé (Cass. Soc. 28 oct. 2009 n° 08-43251).
Cette situation n’est pas sans conséquence pour le salarié lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation et qu’il est ainsi laissé dans l’expectative du fait de l’abstention de l’employeur d’avoir contacté la médecine du travail dans le délai requis.
En cas d’abstention de l’employeur le salarié peut-il prendre l’initiative de saisir la médecine du travail ?
La défaillance de l’employeur est préjudiciable au salarié, qui serait doublement sanctionné s’il était dépourvu de pouvoir agir pour y remédier.
La Cour de cassation y pallie, en jugeant avec constance que
« la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail en avertissant l’employeur de cette demande » (Cass. Soc. 12 nov. 1997 n° 95-40632).
Le salarié peut donc, en l’absence d’initiative de son employeur, prendre lui-même l’initiative de saisir la médecine du travail pour obtenir un rendez-vous.
La validité de sa démarche est, ou était, toutefois conditionnée à ce qu’il en ait préalablement averti l’employeur.
En effet, cette position, qui résulte d’une jurisprudence ancienne, pourrait être à nuancer par de récentes dispositions du Code du travail.
Celui-ci prévoit en effet désormais, dans une section consacrée aux visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail, que :
« Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé » (article R 4624-34 du Code du travail).
Si ce texte n’exige pas d’information préalable de l’employeur, la prudence recommanderait cependant de le faire, le salarié pouvant notamment envoyer un mail à son employeur, en s’assurant qu’il a bien été reçu.
Conséquences de l’absence d’initiative de la visite de reprise par l’employeur
Un employeur avait été sollicité par une salariée, dont l’arrêt de travail allait expirer, afin de bien vouloir organiser sa visite médicale de reprise.
Celui-ci lui avait répondu qu’il l’organiserait dès qu’elle aurait repris le travail.
L’intéressée, estimant cette exigence infondée, avait alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte que sa rupture soit prononcée aux torts de l’employeur.
Déboutée en appel, la Cour de cassation lui avait donné raison, jugeant que :
L’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé ; le refus de l’employeur s’analyse en un licenciement (Cass. Soc. 28 oct. 2009 n° 08-43251 précitée).
Cette solution vient d’être réaffirmée.
Là encore, le salarié s’était heurté à la résistance de la Cour d’appel, qui l’avait débouté, lui reprochant d’avoir « sollicité l’organisation de la visite de reprise, sans manifester la volonté de reprendre le travail » et retenait que l’employeur « a le droit de demander au salarié de revenir dans l’entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise »
Cette motivation surprenante est heureusement censurée par la Haute Juridiction, qui rappelle à nouveau que « l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé » (Cass. Soc. 3 juill. 2024 n° 23-13784).