La cessation d’activité d’une entreprise constitue-t-elle un motif de licenciement économique ? La réponse à cette interrogation doit être nuancée et nécessite d’établir une distinction entre la cessation partielle et la cessation totale d’activité.


La cessation d’activité d’une entreprise constitue-t-elle un motif de licenciement économique ? La réponse à cette interrogation doit être nuancée et nécessite d’établir une distinction entre la cessation partielle et la cessation totale d’activité.

Si la loi Travail du 8 août 2016 a modifié la définition du licenciement pour motif économique en précisant notamment les caractéristiques des difficultés économiques, l’obligation de reclassement, qui constitue également un des critères d’appréciation de la cause économique du licenciement, n’a pas été touchée par cette réforme

L’expression « plan social » relève du registre émotionnel tragique dont s’empare la presse pour illustrer des licenciements économiques massifs, accompagnés fréquemment d’une fermeture d’entreprise. Derrière cette situation dramatique pour ceux qui la vive, s’abrite en droit du travail une réalité juridique imposant des exigences strictes dont la méconnaissance est source de sanction pour l’employeur, et d’indemnisation pour le salarié.

On sait de longue date que lorsqu’une entreprise appartenant à un groupe envisage de procéder à des licenciements pour motif économique, des exigences particulières s’imposent à elle. Celles-ci tiennent autant à l’existence de la cause économique du licenciement qu’à l’obligation de reclassement à laquelle l’employeur est tenu.
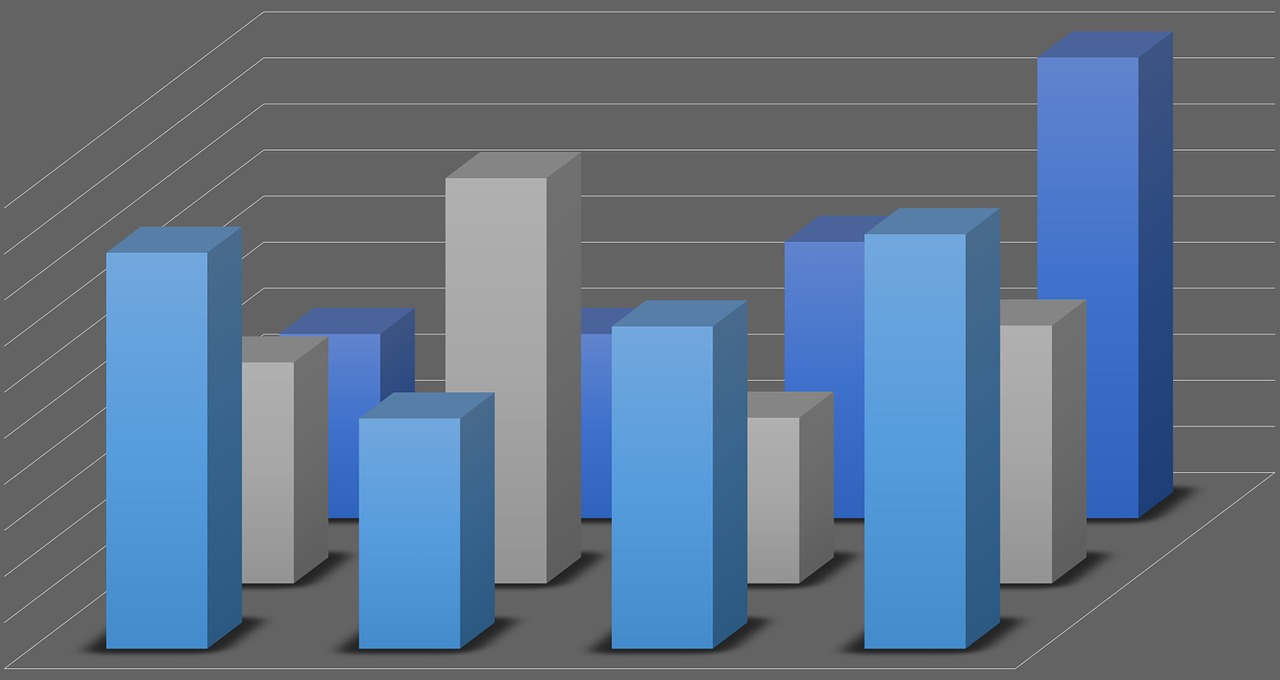
Rarement sous cette législature, une loi aura été l’objet d’autant de contestation, allant même jusqu’à créer la division au sein du parti socialiste, mais il faut désormais se résoudre à l’évidence, la loi « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » (dite loi El Khomri) a été définitivement adoptée le 21 juillet 2016.
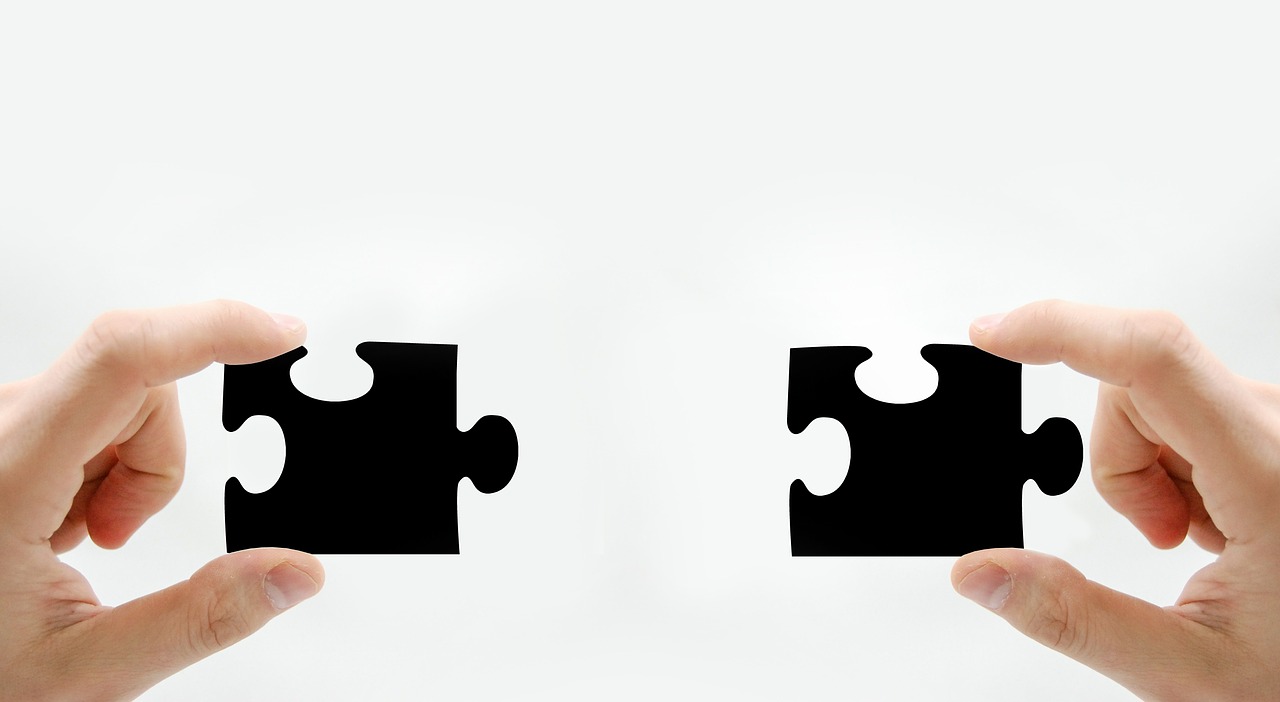
La qualification de coemploi, élaborée par la jurisprudence, a connu des vicissitudes au fil du temps, avec notamment un durcissement de la position de la Cour de cassation appliquée aux licenciements pour motif économique ayant pour effet, compte tenu des exigences posées par cette juridiction, de limiter les cas reconnus de coemploi à une portion congrue. Précisions que le coemploi désignait initialement l’existence d’un lien de subordination exercé conjointement par deux sociétés à l’égard d’un salarié, de sorte que celui-ci dispose en réalité de deux employeurs, et non un seul.

L’affaire CONTINENTAL avait suscité une vive émotion après la fermeture du site de Clairoix (dans l’Oise) et le licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés qui y étaient affectés. 683 salariés avaient alors entrepris de contester leur congédiement, en soutenant deux arguments juridiques devant la juridiction prud’homale. Ils invoquaient, d’une part, que le motif économique allégué par l’employeur ne répondait pas aux exigences légales.
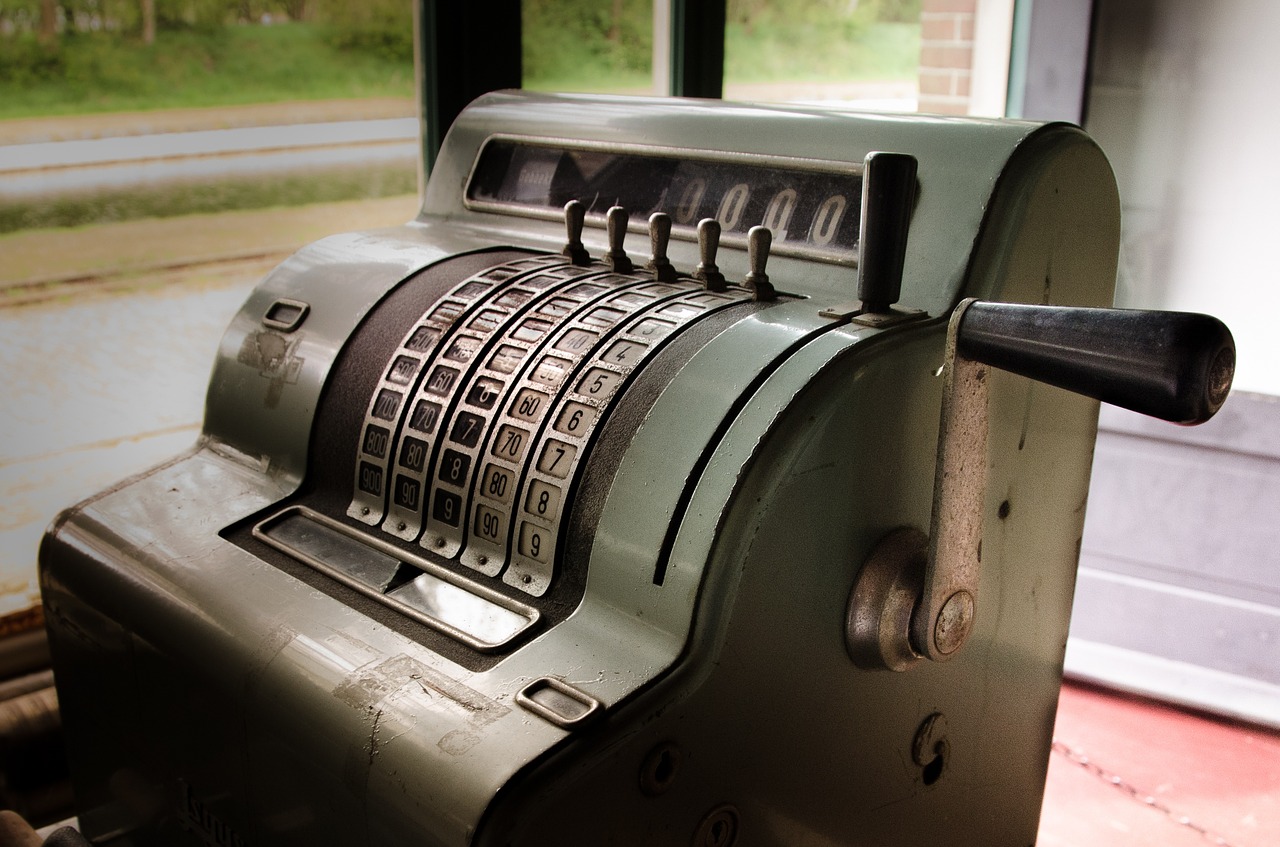
Lorsqu’un salarié est licencié et que du fait de son employeur il n’a pas été en mesure d’exécuter son préavis, il est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, si le Juge, amené à se prononcer sur le litige, a considéré que la rupture de son contrat de travail était injustifiée. C’était ainsi qu’un salarié indûment licencié pour faute grave a droit notamment à une indemnité compensatrice de préavis.

La Chambre sociale de la Cour de cassation serait-elle perméable à l’environnement ambiant, et sous l’influence de la loi El Khomri, qui contient une profonde modification de la définition du licenciement pour motif économique, assouplirait-elle ses exigences relatives au formalisme applicable à la lettre de licenciement ? C’est la question que l’on est en droit de se poser à la lecture d’un arrêt rendu le 3 mai dernier (Cass. Soc. 3 mai 2016 n° 15-11046).

A l’heure où la contestation gronde légitimement contre le projet de loi El Khomry, envisageant une profonde réforme du droit du travail, et que la définition du licenciement pour motif économique, telle qu’interprétée par le Juge, y est remise en cause, quelques réalités méritent d’être rappelées. On sait que la modification projetée par le Gouvernement, qui s’est au passage affranchi de consulter les partenaires sociaux, affecte notamment la définition de la cause économique de licenciement, sans toucher à ses effets (suppression de poste, transformation, modification du contrat de travail).