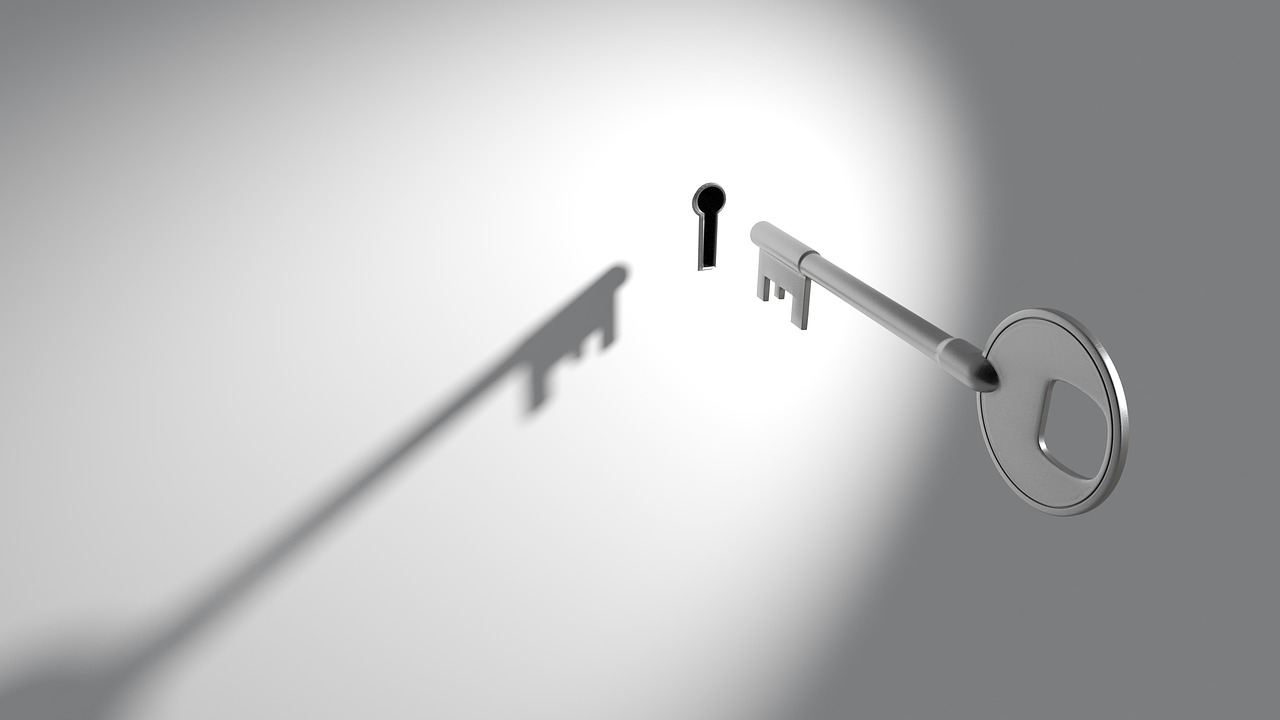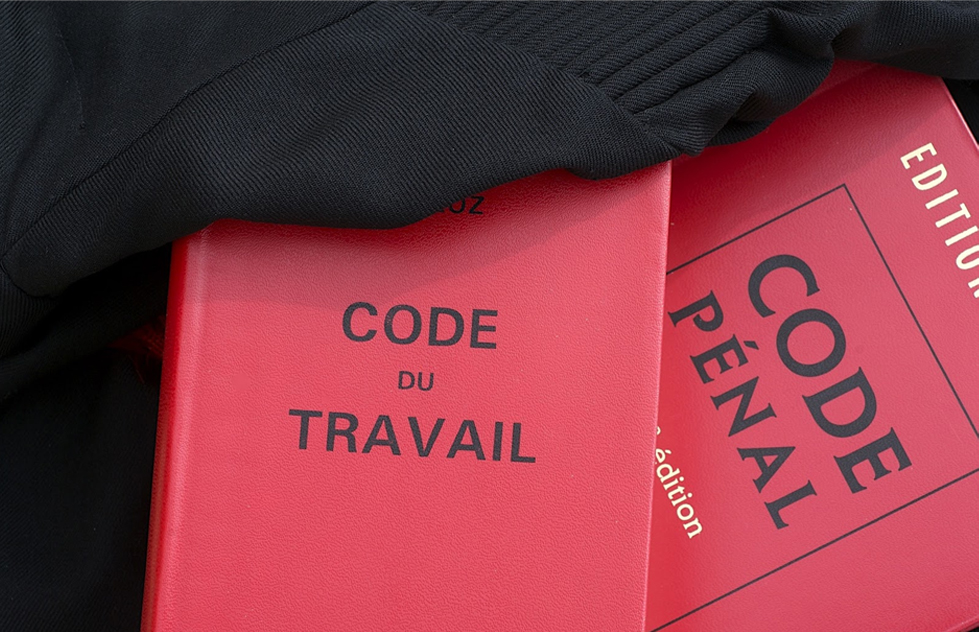Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le salarié qui dénonce le harcèlement moral qu’il subit fait preuve de courage
Le harcèlement moral est, c’est une évidence, une forme de violence inacceptable dans le cadre de la relation de travail.
Les Juges, interprétant la loi, considèrent que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de la volonté de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du Code du travail).
Bien que l’employeur ait juridiquement l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements, et qu’il doive agir sans délai dés lors qu’il est informé de l’existence d’une telle situation, il n’en demeure pas moins que la réalité est parfois quelque peu différente.
Il n’est en effet pas rare qu’un salarié qui se plaint de harcèlement moral soit considéré avec la plus grande suspicion par son employeur.
Cela peut même conduire à son licenciement au motif qu’après vérification, l’employeur estime que le harcèlement n’est pas avéré et que le fait de proférer de telles allégations sans fondement empêche la poursuite de la relation de travail.
On comprend qu’à ce régime, et au regard de la menace qui pèse sur eux, les salariés victimes de ces agissements puissent avoir des hésitations à les dénoncer…
La dénonciation faite par le salarié lui confère toutefois une certaine protection
Afin de le mettre à l’abri des mesures de rétorsion de l’employeur, la jurisprudence assure une protection au salarié de bonne foi, sachant que celle-ci est présumée.
C’est ainsi que la Chambre sociale de la Cour de cassation a d’abord jugé que le fait qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral, ne peut, sauf mauvaise foi de sa part, être licencié.
De sorte que si l’employeur le licenciement alors que l’intéressé était de bonne foi, son licenciement est entaché de nullité (Cass. soc 10 mars 2009 n° 07-44092).
Il incombe en outre à l’employeur de démontrer que le salarié avait agi de mauvaise foi, en se prétendant victime de ses agissements, seule condition pour que son licenciement puisse être considéré comme licite.
Restait à définir la mauvaise foi, qui prête pour le moins à interprétation…
C’est ce que vient de faire la Cour de cassation en jugeant que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. soc 7 février 2012 n° 10-18035).
De sorte que le salarié qui affirme être victime de harcèlement moral, alors qu’il a connaissance que les faits qu’il dénonce sont faux, est passible d’un licenciement, souvent pour faute grave.
Voilà une précision utile qui confine à de strictes limites la mauvaise foi dans ce domaine.