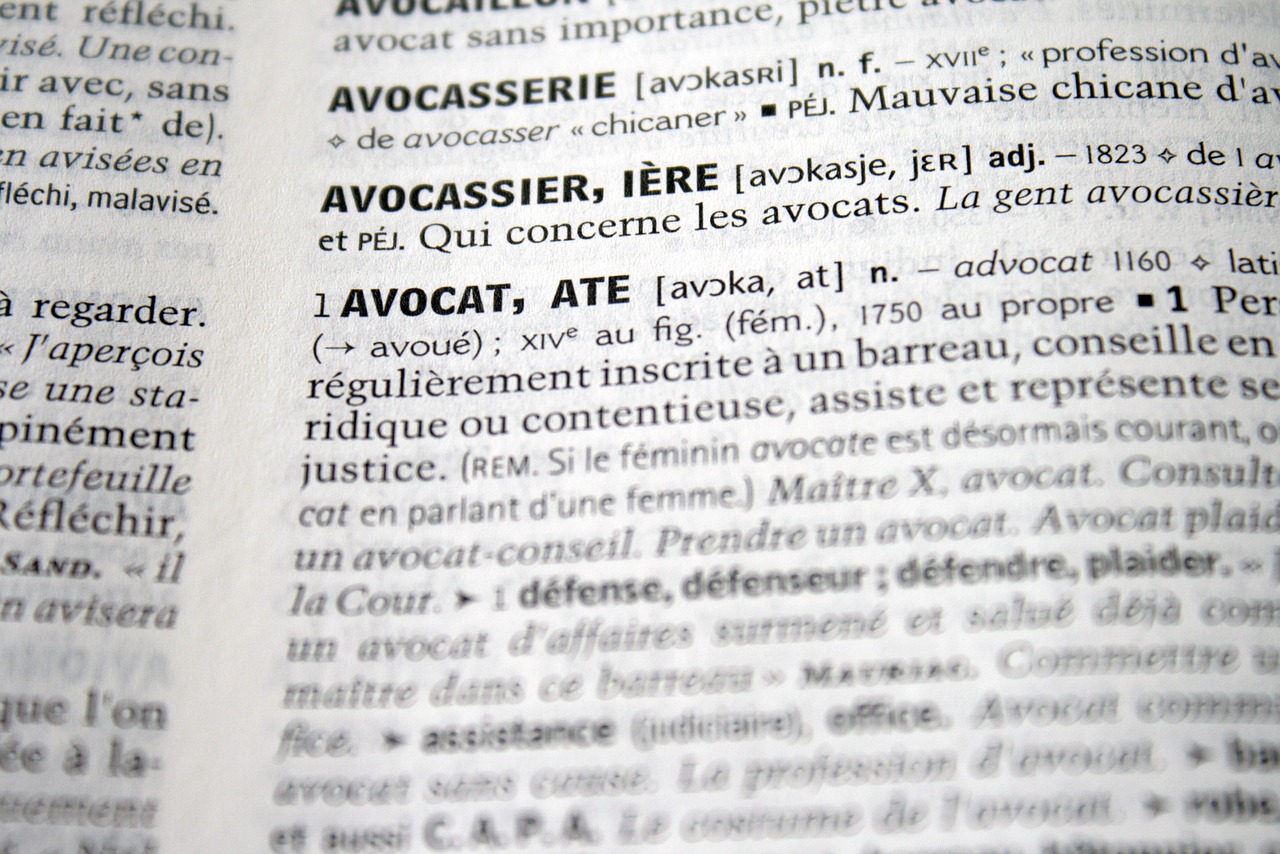Véritable aubaine pour l’employeur qui s’est montré défaillant, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 lui accorde la possibilité de préciser, spontanément ou à la demande du salarié, le motif de licenciement, après qu’il ait envoyé la lettre de licenciement, lui permettant ainsi d’espérer échapper à une sanction