Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
L’insuffisance professionnelle et la faute : deux notions distinctes
Si l’insuffisance professionnelle et la faute constituent tous deux des motifs de licenciement, les deux notions ne doivent pas être confondues
La jurisprudence précise à cet égard que :
« l’insuffisance professionnelle peut être définie, en l’absence d’objectifs contractuellement définis, comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification« (C.A. Poitiers (chb. sociale), 17 octobre 2006. – R.G. n° 06/00795).
En effet, l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, de sorte que lorsque la motivation de la lettre de licenciement repose sur une insuffisance professionnelle qualifiée par l’employeur de fautive, voire de faute grave, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cette règle, énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc. 9 mai 2000 n° 97-45163) conserve toute son actualité.
Étant précisé que c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, conformément aux dispositions du code du travail.
La distinction peut paraître subtile, mais elle présente un intérêt pratique considérable entrainant d’importantes conséquences pour le salarié.
Rappelons que la faute, qu’elle soit grave ou non, relève du registre disciplinaire.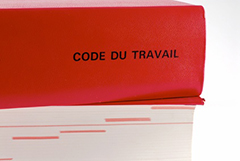
Le Code du travail prévoit à cet égard la mise en œuvre d’un régime disciplinaire très encadré répondant à des exigences procédurales, le salarié disposant en outre de garanties permettant l’observation des droits de la défense.
Il en résulte : 1°- que les faits fautifs reprochés au salarié ne doivent pas être prescrits (la prescription étant acquise au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf lorsqu’ils ont donné lieu à l’exercice de poursuites pénales.),
2°- que ces faits fautifs ne doivent pas avoir été déjà sanctionnés (en application de la règle non bis in idem),
3°- que lorsque l’entreprise est dotée d’un règlement intérieur qui précise les fautes susceptibles d’entraîner un licenciement disciplinaire, l’employeur ne pourra sanctionner que dans les limites prévues par ce texte (Cass. Soc. 23 mars 2017 n° 15-23090).
L’insuffisance professionnelle procède, non pas d’une faute du salarié, mais d’une exécution défaillante de sa prestation de travail
Elle est caractérisée, selon la définition communément admise indiquée ci-dessus, « comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification » (C.A. Poitiers (ch. soc.), 17 octobre 2006. – RG. n° 06/00795).
Il s’agit donc d’une inexécution ou la mauvaise exécution, par un salarié, de sa prestation de travail.
La Cour de cassation énonce avec une parfaite régularité que l’insuffisance professionnelle doit être distinguée de la faute, cette dernière nécessitant une volonté du salarié.
Elle martèle avec constance que l’affirmation que l’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute (Cass. soc. 6 mars 2024 n° 22-19559).
Illustrations de cette distinction
La lettre de licenciement d’un salarié, directeur adjoint d’une agence, invoquait les griefs suivants : des difficultés persistantes dans son mode opérationnel, la mauvaise gestion du départ d’un collaborateur, des résultats médiocres et le non-respect d’instructions dans le cadre d’un dossier.
L’intéressé, qui avait été licencié pour faute grave, avait porté le litige devant la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel avait considéré que les manquements qui lui étaient reprochés relevaient de l’insuffisance professionnelle, et avait requalifié le licenciement de faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision est censurée par la Cour de cassation, qui reproche au juge du fond de ne pas avoir caractérisé la mauvaise volonté du salarié, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 12 oct. 2017 n° 16-14661).
Reste la situation dans laquelle il est difficile de faire la part des choses et de distinguer dans les énonciations de la lettre de licenciement entre griefs disciplinaires et non disciplinaires.
Il a été jugé dans cette hypothèse que lorsque la lettre de licenciement ne permet pas de distinguer entre les griefs disciplinaires et non disciplinaires, le caractère disciplinaire l’emporte, lorsqu’aucune mauvaise volonté délibérée du salarié n’est établie (Cass. Soc. 5 juill. 2017 n° 16-12387).
Ce choix se révèle plus protecteur des intérêts du salarié pour les raisons que nous avons exposées.


