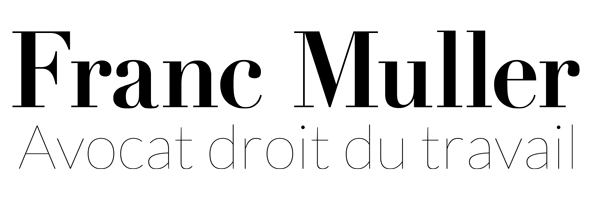Franc Muller – Avocat rupture conventionnelle, Paris
Un montant qui ne peut être inférieur à l’indemnité de licenciement
Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle versé au salarié dont le contrat est rompu de cette manière, ne peut être inférieur au montant minimal spécifique prévu par la loi.
C’est cette réalité, qui n’allait manifestement pas de soi, que la Cour de cassation vient d’énoncer, brisant ainsi toute velléité de déroger à cette règle impérative.
L’article L 1237-13 du Code du travail prévoit en effet que, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, une indemnité spécifique doit être payée au salarié, dont le montant ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement.
A cet égard, la loi précise que l’indemnité de licenciement est due au salarié licencié qui compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Ce qui laisse à supposer, si l’on transpose cette phrase à la rupture conventionnelle, que l’indemnité n’est légalement due qu’au salarié ayant un an d’ancienneté.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement est fixé par l’article R 1234-2 du Code du travail, et « ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, auquel s’joute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
Indemnité légale ou indemnité conventionnelle ?
Mais il s’agit là d’un seuil minimum, et un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 précise que l’indemnité minimale à verser en cas de rupture conventionnelle est l’indemnité conventionnelle de licenciement, c’est à dire celle déterminée par la convention collective applicable, si elle est plus favorable que l’indemnité légale (avenant du 18 mai 2009, étendu par avis d’extension du 9 juillet 2009).
Ainsi, à titre d’exemple, l’indemnité minimale due à un cadre salarié, dont la relation de travail est soumise à la convention collective SYNTEC (des bureaux d’études techniques et des cabinets d’ingénieurs-conseils et des cabinets de conseil), qui est plus favorable que l’indemnité légale, serait d’un tiers de mois par année de présence, conformément à l’article 19 de cette convention collective.
Pour en revenir à l’arrêt commenté, une salariée avait été embauchée par l’entreprise individuelle X, le 6 novembre 1995, et son contrat de travail avait été repris en 2009 par une société Y, l’ancienneté de l’intéressée au 6 novembre 1995 étant expressément maintenue.
La salariée et la société Y avaient conclu une première rupture conventionnelle le 24 février 2010, que la Direction du travail avait refusé d’homologuer, en raison du non respect du délai de rétractation de 15 jours, et du fait qu’aucune indemnité conventionnelle n’était prévue.
Les parties concluaient ensuite une seconde rupture conventionnelle, qui était en définitive homologuée le 2 avril 2010 par la direction du travail.
Quelle ancienneté retenir ?
Cette seconde rupture conventionnelle, signée par la salariée, mentionnait une ancienneté de 9 mois, faisant fi de celle acquise depuis 1995, et aucune indemnité n’y était prévue, ce qui n’avait pas éveillé cette fois-ci la vigilance de la direction du travail.
La salariée s’estimant flouée avait saisi quelques temps après la juridiction prud’homale afin, non pas de poursuivre la nullité de la rupture conventionnelle qu’elle avait conclue et à laquelle elle n’entendait pas renoncer, mais d’obtenir l’octroi d’une indemnité de rupture conventionnelle, ainsi que des dommages-intérêts pour non respect par l’employeur, des dispositions contractuelles et conventionnelles.
Elle avait été déboutée par la Cour d’appel, qui relevait que la direction du travail avait pourtant attiré l’attention de l’intéressée, lors du refus de la première convention, sur le fait qu’aucune indemnité spécifique n’y était prévue, ce qui ne l’avait pas empêché de signer et d’approuver de sa main la seconde convention, qui mentionnait une ancienneté de neuf mois.
Il était également reproché à la salariée de ne pas réclamer la nullité de la convention, ce qui, d’après les Juges d’appel, démontrait sa volonté de rompre son contrat de travail d’un commun accord.
Ce raisonnement est, heureusement, censuré par la Cour de cassation, qui considère au contraire, que ce n’est pas parce que la salariée ne demandait pas l’annulation de la rupture conventionnelle, qu’elle n’était pas fondée à exiger le respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique d’une telle rupture (Cass. soc 10 déc. 2014 n° 13-22134).
De sorte que l’employeur ne pouvait, au prix d’une manœuvre à laquelle la salariée a été (malgré elle ?) associée, éluder l’ancienneté qu’elle avait acquise à seule fin de ne pas lui verser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à laquelle elle avait droit.
Le signal donné par les Hauts magistrats est le bienvenu, alors que l’on s’achemine en 2014 vers un nombre record de ruptures conventionnelles homologuées (environ 320 000 selon les estimations du ministère du travail).
Nous avons déjà souligné ici la position, souvent fragile, d’un salarié lorsqu’il négocie une rupture conventionnelle, alors qu’il se trouve sous la coupe de son employeur.
Les conditions d’annulation de cette convention se limitent à la démonstration par le salarié, qu’il a été victime d’une fraude ou d’un vice du consentement, souvent difficiles à établir.
Il n’aurait plus manqué qu’un salarié, dont la signature aurait été extorquée, renonce à se prévaloir de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, pour que la situation touche à son comble.
Imaginons un instant que la Cour de cassation ait approuvé l’argumentation développée par l’employeur ; c’était ouvrir irrémédiablement la voie à une pente dangereuse au détriment des salariés.