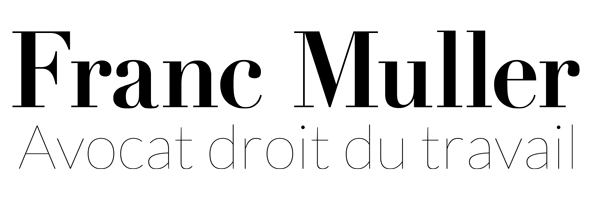La tentation peut être grande pour un employeur de surveiller l’activité de ses salariés, en contrôlant leur productivité.
Le poste informatique qu’il met à leur disposition dans l’entreprise constitue l’outil idéal pour lui en fournir les moyens.
À cet égard, on trouve facilement sur le marché des logiciels espions, dénommés « keyloggers », qui permettent d’enregistrer toutes les frappes effectuées par un salarié sur son clavier.