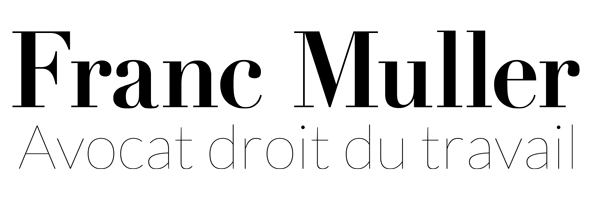Quel salarié – et quel lecteur de ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans doute pourraient répondre par l’affirmative… S’il n’est pas contestable qu’une certaine tolérance est couramment admise, la règle de droit dégagée par la jurisprudence est parfaitement claire et constamment réaffirmée : « Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence »
Deux jours après que le confinement ait été instauré, la Chambre sociale de la Cour de cassation procédait à un revirement de sa jurisprudence concernant la preuve des heures supplémentaires. Celui-ci s’avère assez favorable aux salariés.

Par Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
La prise d’acte est justifiée en cas de graves manquements de l’employeur
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, qui reproche à son employeur de graves manquements.
Si les Juges considèrent qu’elle est justifiée, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié se voit allouer des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le cas échéant, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc 20 janvier 2010, n° 08-43476).
En revanche, s’ils considèrent que la prise d’acte n’était pas justifiée, soit parce que les manquements imputés à l’employeur n’étaient pas fondés, soit parce qu’ils n’étaient pas suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’une démission, ce qui peut avoir pour conséquence que le salarié qui a quitté son emploi immédiatement, sans avoir effectué de préavis, doit être condamné à payer à son employeur une indemnité correspondant au préavis non effectué.
La prise d’acte a été consacrée par la Cour de cassation il y a moins de 10 ans (Cass. Soc. 25 juin 2003, n° 01-42335), et la jurisprudence en affine les contours au fil des décisions.
On savait déjà, notamment, qu’elle était justifiée lorsque l’employeur ne rémunère pas au salarié les heures supplémentaires qu’il a effectué, ou lorsque l’employeur contrevient à son obligation de sécurité, de même qu’en cas de modification unilatérale de la rémunération contractuelle du salarié par l’employeur.
Exemple de décisions justifiant une prise d’acte
Deux décisions récentes nous éclairent encore davantage sur les faits qui légitiment une prise d’acte.
Ainsi, dans une première affaire, une salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir remédié à une situation conflictuelle qui l’avait opposé à sa supérieure hiérarchique pendant plusieurs années, alors qu’il en était informé.
C’est à bon droit que la salariée a agi, ont estimé les Hauts magistrats, qui ont considéré que l’employeur avait laissé perdurer un conflit sans lui apporter de solution et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture (Cass. soc. 17 octobre 2012, n° 11-18208).
Cette décision est d’autant plus intéressante que la salariée n’invoquait pas de harcèlement moral à son égard ; c’est véritablement l’inertie de l’employeur face à un conflit aigu qui est ici sanctionnée.
Dans une deuxième affaire, le salarié avait travaillé pendant une période continue sans prendre de repos week-end compris, après avoir dû participer à un salon professionnel et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour ce fait.
La Cour d’appel l’en avait débouté, jugeant que le salarié avait bénéficié d’un repos compensateur, de sorte que le non-respect par l’employeur des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire présentait un caractère isolé, qui ne justifiait pas une prise d’acte.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au repos hebdomadaire avait nécessairement causé un préjudice au salarié sur le plan de la santé, compte tenu de la durée de son travail continu au sein du salon professionnel, et que la prise d’acte était ainsi justifiée (Cass. soc 31 ocot. 2012 n° 11-20136).
Il est intéressant de noter que le droit à la santé revêt pour les Juges une importance fondamentale, en particulier depuis 2011, lorsque la Cour de cassation avait posé en principe que « le droit à la santé et au repos sont au nombre des exigences constitutionnelles » (soc. 29 juin 2011 n° 09-71107).
Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
A l’heure où les annonces de fermetures d’usines appartenant à des groupes internationaux se multiplient en France, il convient de faire un rappel des obligations qui s’imposent à l’employeur en matière de licenciement pour motif économique, à l’aune de la jurisprudence récente.
Le licenciement pour motif économique obéit à des règles strictes édictées par le Code du travail (article L 1233-3 du Code du travail) et doit ainsi être justifiée :
- soit par des difficultés économiques, qui sont appréciées au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise, lorsqu’elle appartient à un groupe,
- soit par une réorganisation, à la seule condition qu’elle soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise,
- soit par des mutations technologiques.
A défaut de répondre à ces critères, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, avant de procéder au licenciement, l’employeur a l’obligation de reclasser le ou les salariés concernés par cette mesure, en recherchant les emplois vacants qui pourraient leur être proposés (article L 1233-4 du Code du travail).
Cette obligation de reclassement est fondamentale, les Juges la considère comme un élément constitutif de la cause économique de licenciement.
Le périmètre de cette obligation varie : il est limité à l’entreprise lorsque celle-ci est unique, mais l’obligation est beaucoup plus large lorsque l’entreprise appartient à un groupe de sociétés.
Cette obligation est alors renforcée, en ce sens que les recherches de reclassement s’appliquent à de toutes les entreprises du groupe, y compris celles qui sont situées à l’étranger.
En clair, si un emploi est disponible au sein d’une ou plusieurs entreprises du groupe situées à l’étranger, il doit être proposé au salarié dont le licenciement est envisagé.
L’idée directrice est de sauver, autant que possible, l’emploi des salariés et de limiter le nombre des licenciements.
Poussé à l’extrême, on a parfois pu lire dans la presse indignée, que des salariés s’étaient vus proposer avant d’être licenciés, un emploi sans lien avec celui qu’ils occupaient, parfois sous-qualifié et situé dans un pays lointain, en contrepartie d’un salaire dérisoire.
L’employeur répliquait alors en toute bonne foi qu’il se conformait en cela à l’application de la loi et de la jurisprudence.
C’est pour éviter des situations qui pouvaient paraitre absurdes que le législateur a inséré en mai 2010 un nouvel article dans le Code du travail (article L 1233-4-1), prévoyant que lorsqu’une entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, est implanté à l’étranger, l’employeur doit interroger le salarié concerné, préalablement à son licenciement, afin qu’il indique s’il accepterait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, en précisant notamment quels emplois il accepterait, dans quels pays et à quel niveau de rémunération ?
L’obligation de reclassement s’applique avec la même exigence qu’il s’agisse du licenciement d’un salarié, pris isolément, ou de celui de l’ensemble des salariés, concernés par exemple par la fermeture de leur entreprise.
A cet égard, lorsqu’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (plus connu sous l’ancienne dénomination de « plan social ») est mis en œuvre par l’employeur, celui-ci doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement de salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, en effectuant des recherches à l’étranger si l’entreprise appartient à un groupe multinational (article L 1233-61 du Code du travail).
La Cour de cassation nous fournit une récente illustration de l’application de ces principes (Cass. soc. 10 octobre 2012, n° 11-19436).
Une entreprise de dimension internationale, implantée dans 15 pays et employant 14 000 salariés répartis sur 116 sites d’exploitation en Europe, avait fermé un site sur lequel travaillait de nombreux salariés en France, et mis en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Au titre des mesures de reclassement, ce plan proposait un certain nombre d’emplois en France, ainsi qu’un unique emploi en Roumanie.
L’employeur n’établissait pas, en revanche, avoir été dans l’impossibilité de proposer le moindre poste au sein des sociétés du groupe situées à l’étranger, et le plan ne comportait aucune indication sur la nature et la localisation des emplois qui auraient pu être proposés à l’étranger.
Dans le droit fil de la jurisprudence, les Juges ont considéré que les carences de l’employeur entrainaient la nullité du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Et par voie de conséquence, que la nullité du plan rendait nul le licenciement des salariés !
Le droit du travail est souvent formaliste ; un formalisme protecteur des intérêts des salariés.
Le juriste allemand Jhering ne disait il pas : « Ennemis de l’arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » ?
Maître Franc Muller est avocat licenciement sur Paris, il assiste les salariés en licenciement pour motif économique.

A force de recourir habituellement aux contrats à durée déterminée lors de l’embauche d’un salarié, les employeurs en oublieraient presque que l’utilisation de ces contrats est strictement encadrée par la loi. Les cas d’utilisation sont en effet limitativement énumérés par le Code du travail (article L 1242-2).
Franc Muller – Avocat licenciement, Paris
Le contrat à durée indéterminée constitue aujourd’hui un sésame plus que précieux, tant les contrats précaires (contrat à durée déterminée, contrat d’intérim…) paraissent être devenus la norme.
Il convient pourtant de rappeler que le Code du travail prévoit que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail » (article L 1221-2), même si cette affirmation correspond actuellement davantage à un vœux pieux.
Aussi, au terme d’une recherche d’emploi éprouvante, ou après qu’un chasseur de tête ait fait une proposition attractive à un salarié, celui-ci peut s’estimer pleinement rassuré par la conclusion d’une promesse d’embauche conclue avec son futur employeur.
Mais que se passe-t-il lorsque cet employeur ne respecte pas son obligation et refuse d’intégrer le bénéficiaire de cette promesse dans l’entreprise, au mépris de l’engagement qu’il avait pris ?
En préambule à cette interrogation, il importe de bien distinguer la promesse d’embauche d’autres actes qui paraissent similaires.
La promesse d’embauche est écrite, elle est sérieuse et ferme, et doit porter sur un emploi déterminé indiquant une date d’entrée en fonction.
Il ne s’agit donc pas de simples pourparlers, ni même d’une proposition d’emploi, pour lesquels l’employeur conserve la faculté de se rétracter.
La promesse d’embauche est souvent l’aboutissement d’un processus préalable de négociation, qui a fait l’objet d’un accord et de l’acceptation des deux parties.
Les Juges assimilent la promesse d’embauche à un véritable contrat de travail.
Son non-respect peut emporter des conséquences extrêmement préjudiciables pour le salarié.
Il est fréquent que celui-ci, s’il était en poste, ait donné sa démission pour exercer ce nouvel emploi, voire même qu’il ait déménagé pour rejoindre son nouveau lieu d’affectation.
La rupture de la promesse d’embauche s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc 15 décembre 2010, n° 08-42951).
En conséquence, elle expose en cas de litige l’employeur à devoir payer au salarié lésé des dommages intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
Rappelons qu’un acte juridique engage son auteur, et à ce titre qu’une promesse d’embauche n’est librement révocable ni par l’employeur, ni par le salarié.
Maître Franc Muller, avocat licenciement sur Paris, vous assiste dans vos litiges liés à un licenciement.

Les deux temps de l’existence que sont la vie privée et la vie professionnelle peuvent connaître des interférences qui ne sont pas sans conséquence pour le salarié. En voici deux illustrations récentes, aux solutions opposées. Un salarié s’était vu retirer son permis de conduire, en dehors de l’exécution de son contrat de travail, en raison de la perte de la totalité de ses points à l’occasion de la commission de plusieurs infractions au Code de la route.

La rupture conventionnelle rencontre un vif succès depuis son instauration par la loi du 25 juin 2008, il s’en conclurait plus de 20 000 par mois selon les chiffres publiés par le ministère du travail, et le rythme va crescendo. Ce dispositif permet, on le sait, à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (article L 1237-11 C.Trav).

Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le salarié qui dénonce le harcèlement moral qu’il subit fait preuve de courage
Le harcèlement moral est, c’est une évidence, une forme de violence inacceptable dans le cadre de la relation de travail.
Les Juges, interprétant la loi, considèrent que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de la volonté de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L 1152-1 du Code du travail).
Bien que l’employeur ait juridiquement l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements, et qu’il doive agir sans délai dés lors qu’il est informé de l’existence d’une telle situation, il n’en demeure pas moins que la réalité est parfois quelque peu différente.
Il n’est en effet pas rare qu’un salarié qui se plaint de harcèlement moral soit considéré avec la plus grande suspicion par son employeur.
Cela peut même conduire à son licenciement au motif qu’après vérification, l’employeur estime que le harcèlement n’est pas avéré et que le fait de proférer de telles allégations sans fondement empêche la poursuite de la relation de travail.
On comprend qu’à ce régime, et au regard de la menace qui pèse sur eux, les salariés victimes de ces agissements puissent avoir des hésitations à les dénoncer…
La dénonciation faite par le salarié lui confère toutefois une certaine protection
Afin de le mettre à l’abri des mesures de rétorsion de l’employeur, la jurisprudence assure une protection au salarié de bonne foi, sachant que celle-ci est présumée.
C’est ainsi que la Chambre sociale de la Cour de cassation a d’abord jugé que le fait qu’un salarié qui relate des faits de harcèlement moral, ne peut, sauf mauvaise foi de sa part, être licencié.
De sorte que si l’employeur le licenciement alors que l’intéressé était de bonne foi, son licenciement est entaché de nullité (Cass. soc 10 mars 2009 n° 07-44092).
Il incombe en outre à l’employeur de démontrer que le salarié avait agi de mauvaise foi, en se prétendant victime de ses agissements, seule condition pour que son licenciement puisse être considéré comme licite.
Restait à définir la mauvaise foi, qui prête pour le moins à interprétation…
C’est ce que vient de faire la Cour de cassation en jugeant que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce (Cass. soc 7 février 2012 n° 10-18035).
De sorte que le salarié qui affirme être victime de harcèlement moral, alors qu’il a connaissance que les faits qu’il dénonce sont faux, est passible d’un licenciement, souvent pour faute grave.
Voilà une précision utile qui confine à de strictes limites la mauvaise foi dans ce domaine.