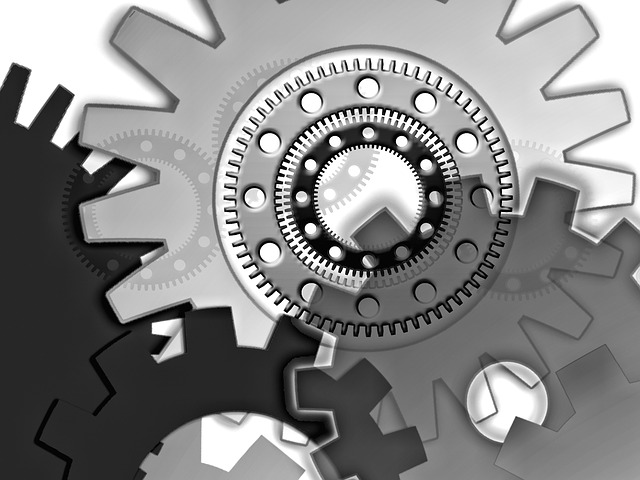Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
Le contrat de travail à temps partiel nécessite l’exigence de mentions précises
Le salarié à temps partiel est considéré par le Code du travail comme celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures), ou si elle lui est inférieure, à la durée conventionnelle (de branche ou d’entreprise) applicable.
Le contrat de travail à temps partiel fait partie, comme le contrat de travail à durée déterminée, de ces contrats formels dont la validité est subordonnée à l’exigence de plusieurs mentions spécifiques.
Doivent notamment être indiqués dans le contrat de travail, qui est obligatoirement écrit (article L 3123-6 du Code du travail) :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Une durée de travail précise qui doit être prévue par le contrat
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures hebdomadaire, sauf si une durée différente est prévue par un accord collectif (article L 3123-17 du Code du travail).
Par dérogation, cette durée peut être inférieure, notamment pour permettre à l’intéressé de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein (article L 3123-7 du Code du travail).
Une durée de travail inférieure à vingt quatre heures est également fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Le salarié à temps partiel peut touefois effectuer des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures supplémentaires, il s’agit d’heures excédant la durée stipulée dans le contrat de travail mais qui ne peuvent excéder la durée légale ou conventionnelle du travail (à défaut, il s’agit d’heures supplémentaires).
L’exécution d’heures complémentaires donne droit à majoration de salaire.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail (article L 3123-19 du Code du travail).
Le formalisme du contrat à temps partiel est déterminant.
La jurisprudence considère en effet que l’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve (1°) de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, (2°) que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et enfin (3°), qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur (Cass. soc. 17 déc. 2014 n° 13-20627).
 Cette règle prétorienne est solidement ancrée.
Cette règle prétorienne est solidement ancrée.
Ainsi, un salarié engagé en qualité de guide conférencier par l’office du tourisme de la ville de Bourges, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, avait saisi la juridiction prud’homale, notamment aux fins de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet.
Le salarié avait été débouté par la Cour d’appel, qui avait jugé que les plannings étaient établis en fonction de ses disponibilités, que les guides conférenciers, dont l’intéressé, étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir, que le salarié avait des activités annexes, que l’office du tourisme tolérait les changements de dernière minute et que chaque attribution de visite, même inopinée, n’était effectuée qu’après validation par le guide sollicité.
La Cour de cassation rejette ces arguments.
Elle relève au contraire que les documents contractuels ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et que la circonstance que les plannings étaient établis à l’avance et en fonction des disponibilités du guide-conférencier était sans effet sur les exigences légales relatives aux mentions exigées par le Code du travail et sur l’obligation pour l’employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue (Cass. soc 25 mars 2015 n° 13-24502).
De sorte que la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein était justifiée.
L’importance pour le salarié de vérifier que la durée du travail est indiquée contractuellement, ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
L’employeur a l’obligation de prévoir dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, la même sanction que précédemment est encourue.
Le contrat de travail d’un salarié mentionnait un horaire mensuel de 86,67 heures et indiquait que « ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires ».
Le salarié avait été débouté de sa demande requalification en contrat à temps complet, faute de justifier avoir remis en cause cette organisation de son temps de travail et d’avoir demandé expressément à son employeur de déroger à la liberté d’organisation de son temps de travail dont il bénéficiait.
La décision est censurée, la Chambre sociale de la Cour de cassation reprochant aux Juges d’appel de ne pas avoir constaté, que le contrat de travail mentionnait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (Cass. soc. 17 nov. 2021 n° 20-10734).