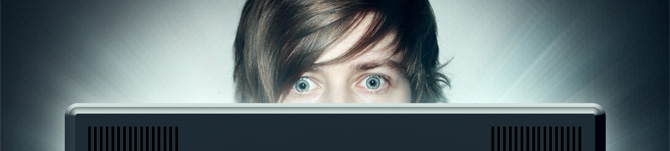S’il est un élément du contrat de travail qui présente un caractère déterminant tant pour le salarié que pour l’employeur, c’est bien la rémunération.
Il est courant que la rémunération du salarié se compose d’une partie fixe, à laquelle s’ajoute une part variable, dont le montant, prévu par avance, est fixé en fonction de la réalisation d’objectifs à atteindre.
Ce mode de rémunération incitatif connaît un certain succès.
S’agissant d’un élément contractuel, on en tire pour conséquence que la rémunération d’un salarié ne peut être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord (Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-69175).
Le contentieux s’est rapidement cristallisé autour des modalités de détermination des objectifs et de leur paiement par l’employeur.
Il importe tout d’abord de préciser que le Code du travail (article L 1321-6) prévoit que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.