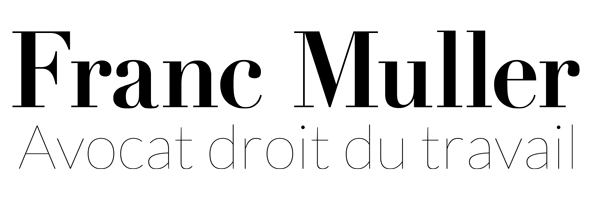Franc Muller – Avocat droit du travail, Paris
La fourniture temporaire de main d’œuvre à une entreprise est strictement prévue par le Code du travail, et ne peut, normalement, trouver application que dans le contexte du travail intérimaire, voire du portage salarial.
Le Code du travail énonce en effet que « le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission » (article L 1251-1).
Le législateur a en outre précisé que « «toute activité de travail temporaire s’exerçant en dehors d’une telle entreprise (de travail temporaire) est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif » (article L 1251-3 du Code du travail).
Ce texte autorise certes le recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif, mais interdit le prêt de main d’œuvre à but lucratif, qui ne s’exercerait pas dans le contexte règlementé.
Pourtant en pratique, il n’est pas inhabituel que des sociétés de services, notamment des SSII, contournent la loi en mettant des salariés à disposition d’entreprises utilisatrices dans des conditions qui relèvent du prêt illicite de main d’œuvre.
Le cas se pose ainsi lorsqu’un salarié, en particulier un cadre disposant de compétences techniques reconnues, est embauché par une société de services X, pour être « prêté » le temps d’une mission à une autre société de services Y, laquelle l’affectera à une entreprise utilisatrice avec laquelle elle a conclu un contrat.
Par principe en effet, une société de services affecte ses salariés à l’accomplissement d’une mission, dont la durée varie, auprès d’une entreprise utilisatrice qui la rémunère pour la prestation exécutée.
Dans une affaire que nous avons récemment plaidée, la Cour d’appel de Versailles a condamné l’employeur à payer des dommages intérêts à un salarié, placé dans une telle situation, pour prêt illicite de main d’œuvre.
L’article L 8241-1 du Code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.
Cet article précise qu’une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Ce qui signifie, a contrario, que lorsque l’entreprise prêteuse facture d’autres frais que les salaires versés, les charges sociales et les frais remboursés, le prêt de main d’œuvre est illicite.
En l’espèce, le salarié avait été embauché par la société A. par contrat à durée indéterminée, et avait dés son engagement été prêté à la société C., qui était très intéressée par ses compétences, elle l’avait aussitôt envoyé en mission auprès d’une entreprise utilisatrice, une banque en l’occurrence.
Il semble au demeurant que les sociétés A. et C. avaient instauré un mode opératoire dans lequel elles se rendaient mutuellement service, s’échangeant au gré de leurs besoins, leurs salariés respectifs.
Or, à l’expiration de sa mission qui avait été plus courte que prévue, le contrat de travail de ce salarié, dont la période d’essai avait précautionneusement été renouvelée par son employeur, avait été rompu.
L’intéressé soutenait, devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel, que la convention liant les sociétés A. et C. avait pour objet exclusif la fourniture de main-d’œuvre moyennant rémunération sans transmission d’un savoir-faire ou mise en œuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse, l’action de la société C. se limitant exclusivement à le mettre à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la banque S.
Cette argumentation a été approuvée successivement par les premiers Juges, puis par la Cour d’appel.
Les magistrats ont considéré que le salarié n’effectuait aucune prestation de travail pour le sous-traité, la société C.
En outre, dans le cadre du débat judiciaire, l’employeur s’était gardé de communiquer les détails, notamment financiers, de la relation qui le liait à la société C.
Il ne justifiait pas davantage qu’une quelconque prestation de services ait été effectuée par le salarié au bénéfice de cette société C.
En conséquence, le prêt illicite de main d’œuvre était établi.
Le salarié, qui a eu le détestable sentiment d’être traité comme un chien dans un jeu de quilles, a ainsi eu la satisfaction d’être indemnisé.
Il convient également de préciser que le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre est passible de sanctions pénales (article L 8243-1 du Code du travail).